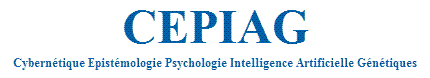Hommage à Guy Cellérier
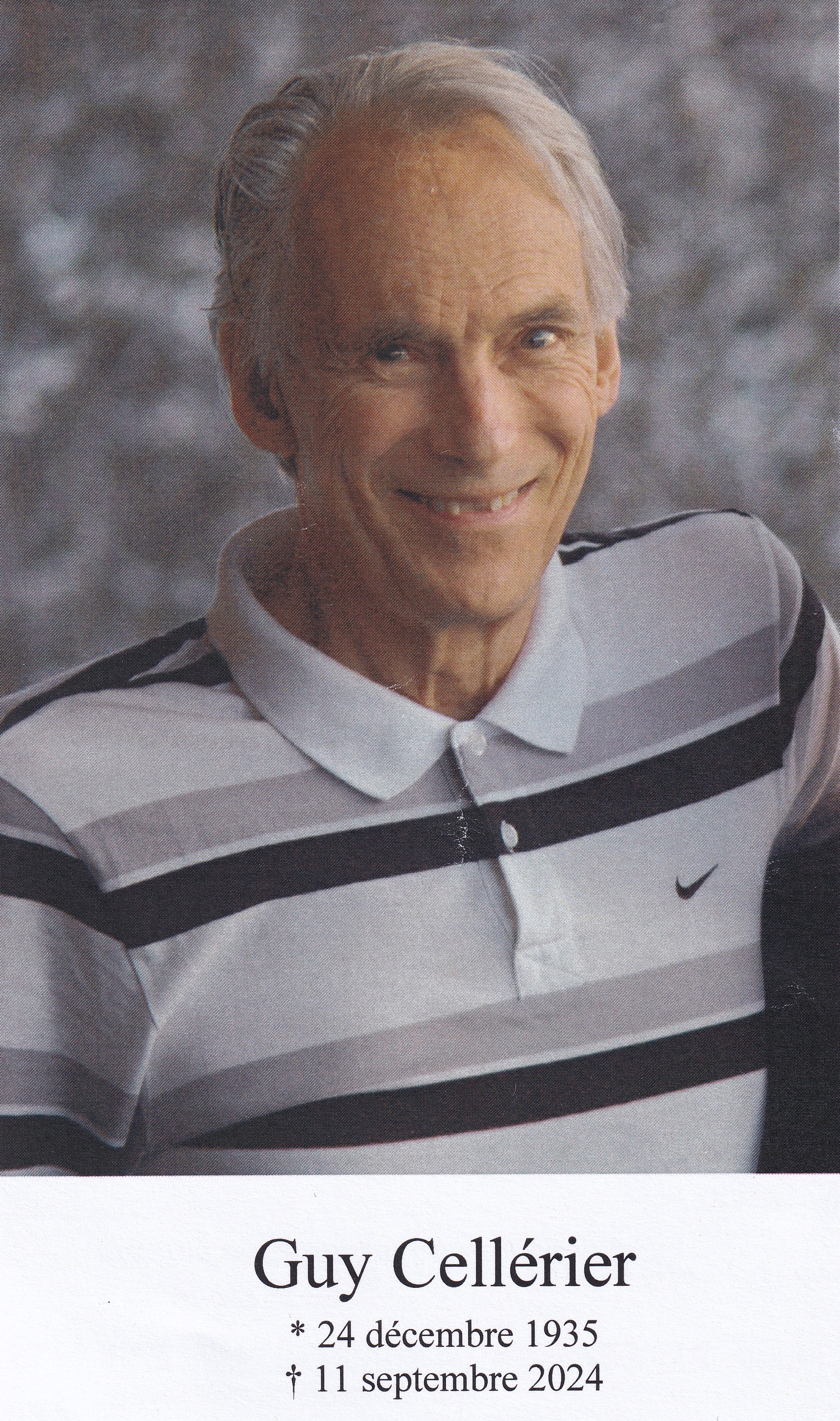 Guy est un maître et un ami. Il fait partie de ces personnes avec
lesquelles la présence et le dialogue se poursuivent au-delà de
leur absence. Il habitait
littéralement l’œuvre de Piaget, mais le
Piaget qu’il habitait n’était pas un
refuge, un “logement de fonction”, mais une
ouverture sur le monde.
Co-directeur du Centre d’Épistémologie
de Genève, il a pleinement rempli la
mission que lui avait donné “le patron”.
Il s’agissait de relier ses travaux
sur la psychogenèse des enfants avec les avancées
produites par le modèle
cybernétique à la fin des années 60.
La thèse de Guy Cellérier parue dans “Cybernétique et
Épistémologie” aux PUF en 1968 a
montré qu’il y avait grand
profit à se pencher sur
l’épistémologie des machines
cybernétiques. Il y avait
même là une méthode de
contrôle expérimentale fournissant le
complément indispensable de l’épistémologie
génétique pratiquée sur le vivant et
son développement spontané.
En réalisant ce lien avec le vivant,
Guy opérait une avancée
épistémologique fondamentale qui me
paraît actuelle et
prophétique dans les débats autour de
l’Intelligence Artificielle et les
Sciences Cognitives, leur rôle et leurs limites. Il sortait
le cybernétique
d’une vision mécaniciste
réservée aux ingénieurs, incompatible
dans cette visée, avec les systèmes vivants ouverts
à l’information et à
l’évolution. Il
revient en effet à Guy le mérite
d’avoir donné une vision fonctionnaliste et
cybernétique de
l’épistémologie piagétienne.
Dans une conception qu’on pourrait
appeler néo-piagétienne, et qu’il a
qualifié de pluriconstructiviste, les
stades de Piaget fonctionnent par vagues successives
emboîtées les unes dans
les autres. Ils sont ainsi dirigés, plus
précisément gouvernés par
différents systèmes de valeurs (“value governed
system” comme Guy se plaisait à dire),
éthologiques et praxiques au début puis
esthétiques, aléthiques et éthiques au
fur et à mesure du développement.
Guy est un maître et un ami. Il fait partie de ces personnes avec
lesquelles la présence et le dialogue se poursuivent au-delà de
leur absence. Il habitait
littéralement l’œuvre de Piaget, mais le
Piaget qu’il habitait n’était pas un
refuge, un “logement de fonction”, mais une
ouverture sur le monde.
Co-directeur du Centre d’Épistémologie
de Genève, il a pleinement rempli la
mission que lui avait donné “le patron”.
Il s’agissait de relier ses travaux
sur la psychogenèse des enfants avec les avancées
produites par le modèle
cybernétique à la fin des années 60.
La thèse de Guy Cellérier parue dans “Cybernétique et
Épistémologie” aux PUF en 1968 a
montré qu’il y avait grand
profit à se pencher sur
l’épistémologie des machines
cybernétiques. Il y avait
même là une méthode de
contrôle expérimentale fournissant le
complément indispensable de l’épistémologie
génétique pratiquée sur le vivant et
son développement spontané.
En réalisant ce lien avec le vivant,
Guy opérait une avancée
épistémologique fondamentale qui me
paraît actuelle et
prophétique dans les débats autour de
l’Intelligence Artificielle et les
Sciences Cognitives, leur rôle et leurs limites. Il sortait
le cybernétique
d’une vision mécaniciste
réservée aux ingénieurs, incompatible
dans cette visée, avec les systèmes vivants ouverts
à l’information et à
l’évolution. Il
revient en effet à Guy le mérite
d’avoir donné une vision fonctionnaliste et
cybernétique de
l’épistémologie piagétienne.
Dans une conception qu’on pourrait
appeler néo-piagétienne, et qu’il a
qualifié de pluriconstructiviste, les
stades de Piaget fonctionnent par vagues successives
emboîtées les unes dans
les autres. Ils sont ainsi dirigés, plus
précisément gouvernés par
différents systèmes de valeurs (“value governed
system” comme Guy se plaisait à dire),
éthologiques et praxiques au début puis
esthétiques, aléthiques et éthiques au
fur et à mesure du développement.
Cette conception se précise dans son originalité et dans son pouvoir heuristique dans l’élargissement et l’enrichissement produit par Guy, en la reliant à la “théorie des trois cerveaux” de Papez et Mac Lean, que Marvin Minsky, dans sa “Society Theory of Mind” a quelque peu reconfigurée dans sa théorie du Cerveau A et du Cerveau B. Ces trois cerveaux, le reptilien, le mammifère et le simien constituent la complexité tri-unitaire de l’architecture psychologique du sujet humain, isomorphe à la succession et au fonctionnement des stades relevés par Piaget. Ces trois systèmes se sont développés et réorganisés progressivement au cours de la phylogenèse. C’est ce qui explique pourquoi ils ne fonctionnent pas selon une hiérarchie verticale où le dernier résultat de cette co-évolution (le niveau simien ou représentatif) utiliserait régulièrement à son service les deux précédents (le niveau reptilien et mammifère ou l’habituel et l’instinctif). Chacun de ces systèmes doit pouvoir se subordonner les autres selon la fonction à emplir. Chacun peut ainsi remplir les deux rôles de supérieur et de subordonné. La relation qui unit ces systèmes est donc celle de l’hétérarchie (terme emprunté à W. Mac Culloch), les diverses organisations qui prennent forme n’étant jamais que provisoires et fluctuantes. Guy Cellérier dans cette reconceptualisation a produit là un travail novateur qui ouvrait l’œuvre de son maître sur la clinique et notamment la clinique actuelle des problèmes appelés “psychosomatiques” ainsi que toute la clinique du traumatisme, en fait toute situation où le sujet peut se sentir menacé dans sa survie et son intégrité tant somatique que psychique. Dans ces problématiques ce sont les mécanismes liés aux cerveaux reptiliens et mammifères, le sensorimoteur chez Piaget, qui sont chargés d’assurer la sécurité et la survie du sujet. Ils vont donc subordonner activement le système représentatif (simien ou hominien) à leur fonctionnement. En faisant cette ouverture Guy révélait une sorte de figure cachée chez le maître genevois : son intérêt pour la clinique et en particulier tout ce qui touchait au domaine de la thérapie...
Je ne voudrais pas que mon intérêt et mon engagement
de thérapeute d’inspiration
systémique, limitent l’étendue des
domaines dans lesquels Guy a su montrer sa
grande pertinence. Il faudrait ainsi citer le juridique
(c’est autour de Kelsen
et de la norme fondamentale dans le domaine du droit que Guy a
rencontré au
départ Piaget), la biologie,
l’éthologie, les mathématiques, la
logique... Il s’envolait d’un domaine à
l‘autre et ceux qui voulaient le suivre auraient
voulu que “ses ailes de géant” lui
permettent de marcher et de reprendre
souffle. Pour lui, l’intelligence
c’était ce qui permettait de faire des liens
et c’est ce qu’il faisait en se confrontant tant au
domaine des sciences
humaines que des sciences dites exactes. C’était
un homme aux semelles de vent
et tous ceux qu’il passionnait et voulaient le suivre se
sentaient un peu “Sancho Pança” quelque peu
débalancés devant les chevauchées
infatigables et passionnées de ce très cher Don Quichotte. Un Don
Quichotte au sens où nous le
décrit William Marx dans “Un
été avec Don Quichotte” :
“Le cerveau de Don Quichotte nous découvre les rouages mêmes
de la création ; il nous
fait pénétrer au cœur des
mécanismes de la fabulation, mise en branle de
manière opiniâtre par un besoin de sens jamais
rassasié, toujours à combler.
Inventer un univers, créer à profusion, en toute
circonstance des êtres et des
mondes...” Je crois que Guy ne portera pas ombrage de ce
rapprochement car il disait lui-même que toute théorie était
à la base une fiction !
Olivier Real del Sarte - Lau Xori 24.11.24